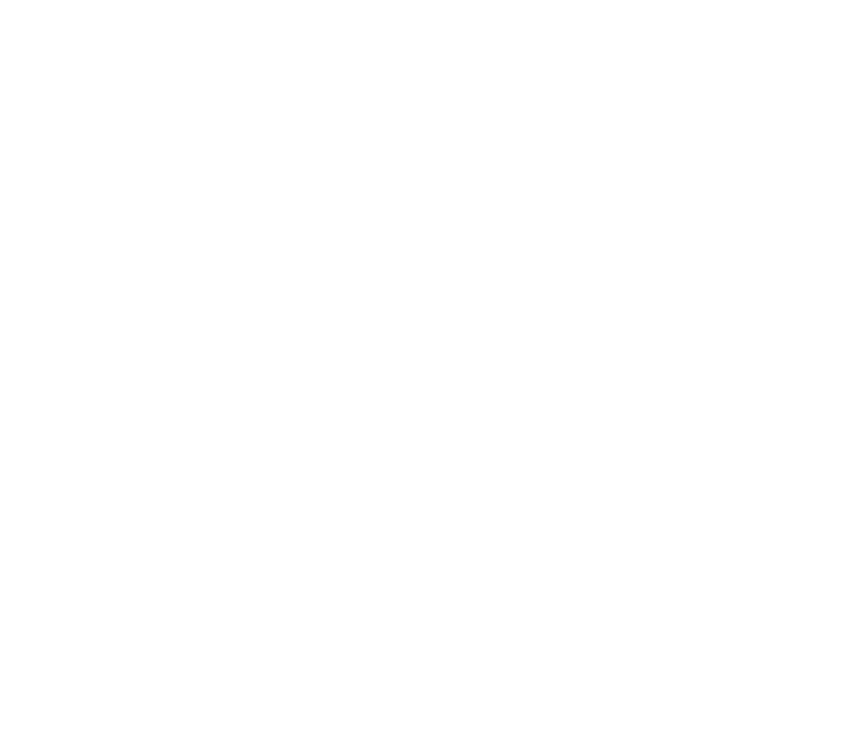UNICEF/Dejongh
Aller à :
Les technologies numériques occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Elles atteignent les coins les plus reculés du monde. Elles créent même de nouveaux mondes, où l’on peine à distinguer le réel de l’imaginaire. L’éducation ne peut pas y rester imperméable, bien que l’on appelle à la protéger des influences négatives des technologies numériques. Il s’agit toutefois d’un défi majeur, car la technologie prend plusieurs formes dans le secteur de l’éducation. Il s’agit d’une ressource, d’un moyen d’exécution, d’une compétence et d’un outil de planification, et elle est porteuse d’un contexte social et culturel, autant d’éléments qui soulèvent des questions et des problèmes spécifiques.
Le postulat du rapport est que la technologie doit être au service des personnes et que la technologie dans le secteur de l’éducation doit placer les apprenants et les enseignants au centre. L’équipe du rapport s’est efforcée de ne pas adopter une vision trop centrée sur la technologie ou affirmer que la technologie est neutre. Le rapport rappelle également que, étant donné qu’un grand nombre de technologies n’ont pas été conçues pour l’éducation, leur caractère adapté et leur valeur doivent être prouvés en relation avec une vision de l’éducation centrée sur l’humain. Les décideurs sont confrontés à quatre compromis difficiles :
- L’appel à la personnalisation et à l’adaptation va à l’encontre de la nécessité de maintenir la dimension sociale de l’éducation. Ceux qui appellent à une plus grande individualisation n’ont peut-être pas saisi la finalité de l’éducation. Les technologies doivent être conçues conformément aux besoins d’une population variée. Un outil d’aide à l’enseignement et à l’apprentissage peut être un fardeau pour certains et une distraction pour d’autres.
- Il faut trouver un équilibre entre l’inclusion et l’exclusion. Les technologies peuvent offrir une bouée de sauvetage éducative à beaucoup de personnes. Néanmoins, pour beaucoup d’autres, elles soulèvent un obstacle supplémentaire à l’égalité des chances en matière d’éducation, avec l’émergence de nouvelles formes d’exclusion numérique. Il ne suffit pas de reconnaître que chaque technologie a des adeptes précoces et tardifs ; il faut également agir. Il faut respecter le principe de l’égalité dans l’éducation et l’apprentissage.
- La sphère commerciale et l’intérêt commun ont des trajectoires différentes. L’influence croissante du secteur des technologies éducatives sur la politique éducative aux niveaux national et international est source de préoccupation. L’exemple le plus frappant est la façon dont la promesse de ressources éducatives ouvertes et d’un Internet ouvrant l’accès à du contenu éducatif n’est souvent pas tenue. Il est nécessaire de mieux comprendre et d’exposer les intérêts qui sous-tendent l’utilisation des technologies numériques dans l’éducation et l’apprentissage pour s’assurer que les pouvoirs publics et les éducateurs accordent la priorité au bien commun.
- On part généralement du principe que tout avantage en matière d’efficacité offert par les technologies éducatives à court terme se poursuivra à long terme. On présente ces technologies comme un investissement judicieux, permettant de faire des économies de main-d’oeuvre, et qui pourrait même remplacer les enseignants. Néanmoins, bien souvent, leurs coûts économiques et environnementaux totaux sont sous-estimés et ne sont pas viables. La capacité de beaucoup de personnes à utiliser les technologies dans l’éducation est limitée. Par ailleurs, il est temps de mettre en lumière le coût des technologies éducatives sur le plan de la durabilité environnementale et de se demander si ces technologies renforcent véritablement la résilience des systèmes éducatifs.
Plus récemment encore, un compromis entre les machines et les êtres humains a émergé dans le contexte des débats autour de l’intelligence artificielle générative, dont on commence seulement à discerner les conséquences pour l’éducation. Ces fractures tiraillent le secteur de l’éducation entre l’espoir suscité par le potentiel des technologies numériques et les risques et les effets néfastes indéniables liés à leur application. C’est au niveau des compromis qu’il faut ouvrir un débat démocratique plus complexe.
Tout changement n’est pas porteur de progrès. Ce n’est pas parce que l’on peut faire quelque chose qu’il faut le faire. Les changements doivent survenir conformément aux conditions des apprenants pour éviter de répéter ce que l’on a observé pendant la pandémie de COVID-19, c’est-à-dire une explosion de l’apprentissage à distance qui a laissé de côté des centaines de millions de personnes.
On ne peut pas toujours s’attendre à ce que des technologies créées pour d’autres usages soient appropriées dans tous les contextes éducatifs, et ce pour tous les apprenants. On ne peut pas non plus toujours s’attendre à ce que les réglementations adoptées en dehors du secteur de l’éducation couvrent tous les besoins de ce secteur. Dans le cadre de ce débat, le rapport lance un appel en faveur d’une vision claire pour orienter les réflexions mondiales concernant ce qui est le meilleur pour l’apprentissage des enfants, en particulier pour les plus marginalisés.
La campagne « #TechOnOurTerms » appelle à prendre des décisions concernant les technologies éducatives qui donnent la priorité aux besoins des apprenants après avoir évalué si leur application est appropriée, équitable, fondée sur des données probantes et durable. Il est essentiel d’apprendre à vivre aussi bien avec les technologies numériques que sans elles ; de prendre ce qui est nécessaire dans une mer d’informations mais d’ignorer ce qui ne l’est pas ; de laisser la technologie soutenir, mais jamais remplacer, la connexion humaine sur laquelle reposent l’enseignement et l’apprentissage.
Par conséquent, les quatre questions suivantes ont été principalement formulées à l’intention des pouvoirs publics, car il leur incombe de protéger et de réaliser le droit à l’éducation. Cependant, elles ont aussi vocation à servir d’outil de plaidoyer pour tous les acteurs de l’éducation engagés à soutenir les progrès en vue de l’ODD 4, afin de s’assurer que les efforts visant à promouvoir la technologie, y compris l’intelligence artificielle, tiennent compte de la nécessité de relever les principaux défis de l’éducation et de respecter les droits humains.
Lorsqu’ils envisagent d’adopter des technologies numériques, les systèmes éducatifs doivent toujours veiller à placer l’intérêt supérieur des apprenants au coeur d’un cadre fondé sur les droits. Il faut se concentrer sur les résultats d’apprentissage, et non sur les ressources numériques. Afin de contribuer à améliorer l’apprentissage, les technologies numériques ne doivent pas se substituer aux interactions en personne avec les enseignants, mais les compléter.
L’utilisation des technologies éducatives est-elle appropriée aux contextes nationaux et locaux ?
Les technologies éducatives devraient renforcer les systèmes éducatifs et être alignées sur les objectifs définis.
Par conséquent, les pouvoirs publics devraient :
- Réformer le programme d’enseignement pour cibler l’enseignement des compétences essentielles qui sont les plus adaptées aux outils numériques dont il est prouvé qu’ils améliorent l’apprentissage et qui sont sous-tendues par une théorie claire de la manière dont les enfants apprennent, sans partir du principe soit que la pédagogie peut rester inchangée, soit que ces technologies numériques sont adaptées à tous les types d’apprentissage. „
- Concevoir, suivre et évaluer des politiques relatives aux technologies éducatives avec la participation des enseignants et des apprenants afin de s’inspirer de leurs expériences et de leurs contextes et de garantir que les enseignants et les animateurs sont suffisamment formés à comprendre comment utiliser les technologies numériques aux fins de l’apprentissage, et non pas simplement à utiliser une technologie spécifique. „
- Garantir que les solutions sont conçues en fonction de leur contexte et que les ressources sont disponibles dans plusieurs langues nationales, sont acceptables sur le plan culturel et adaptées à l’âge ciblé, et incluent des points d’entrée clairs pour les apprenants dans des contextes éducatifs donnés.
L’utilisation des technologies éducatives laisse-t-elle des apprenants de côté ?
Bien que l’utilisation des technologies puisse favoriser l’accès au programme d’enseignement pour certains élèves et accélérer certains résultats d’apprentissage, la numérisation de l’éducation risque également de profiter aux apprenants déjà privilégiés et de marginaliser encore plus d’autres élèves, creusant ainsi les inégalités d’apprentissage.
Par conséquent, les pouvoirs publics devraient :
- Se concentrer sur la manière dont les technologies numériques peuvent soutenir les plus marginalisés afin que tous puissent profiter de leur potentiel, quels que soient leur milieu, leur identité ou leurs capacités, et veiller à ce que les ressources et les appareils numériques soient conformes aux normes d’accessibilité mondiales. „
- Définir des objectifs nationaux concernant la connectivité Internet effective des écoles, dans le cadre du processus d’établissement des points de référence pour l’ODD 4, et cibler les investissements en conséquence afin de permettre aux enseignants et aux apprenants de profiter d’une expérience en ligne sûre et productive à un coût abordable, conformément au droit à une éducation gratuite. „
- Promouvoir les biens publics numériques dans l’éducation, y compris les formats de publication électronique librement accessibles, les ressources éducatives en libre accès adaptables, les plateformes d’apprentissage et les applications de soutien aux enseignants, tous conçus pour ne laisser personne de côté.
Peut-on adapter cette utilisation des technologies éducatives à différentes échelles ?
Il existe d’innombrables produits et plateformes technologiques dans l’éducation et il faut souvent prendre des décisions à leur sujet sans disposer de données probantes suffisantes sur leurs avantages ou leurs coûts.
Par conséquent, les pouvoirs publics devraient :
- Mettre en place des organismes chargés d’évaluer les technologies éducatives, d’échanger avec tous les acteurs capables de réaliser des recherches indépendantes et impartiales, et de définir des normes et des critères d’évaluation clairs, dans l’objectif de parvenir à des décisions publiques fondées sur des données probantes en matière de technologies éducatives. „
- Entreprendre des projets pilotes dans des contextes qui reflètent avec précision le coût total de l’appropriation et de la mise en oeuvre, en tenant compte du coût potentiellement plus élevé des technologies pour les apprenants marginalisés. „
- Garantir la transparence des dépenses publiques et des conditions des accords conclus avec les entreprises privées afin de renforcer la redevabilité ; évaluer la performance afin de tirer des enseignements des erreurs commises, y compris sur des questions allant de la maintenance aux coûts d’abonnement ; et promouvoir des normes d’interopérabilité afin d’améliorer l’efficacité.
Cette utilisation des technologies encourage-t-elle des avenirs éducatifs durables ?
Il ne faut pas considérer les technologies numériques comme un projet à court terme. Il faut les mettre à profit pour en tirer des bénéfices durables, au lieu de se laisser guider par des préoccupations économiques étroites et des intérêts particuliers.
Par conséquent, les pouvoirs publics devraient :
- Mettre en place un programme d’enseignement et un cadre d’évaluation des compétences numériques généraux et non rattachés à une technologie spécifique, qui tiennent compte de ce qui est appris en dehors des salles de classe et qui permettent aux enseignants et aux apprenants de tirer parti du potentiel des technologies dans l’éducation, le travail et la citoyenneté. „
- Adopter et mettre en oeuvre des lois, des normes et des bonnes pratiques convenues afin de protéger les droits humains, le bien-être et la sécurité en ligne des apprenants et des enseignants, en tenant compte du temps d’écran et de connexion, de la vie privée et de la protection des données ; afin de garantir que les données produites dans le cadre de l’apprentissage numérique et au-delà sont analysées uniquement en tant que bien public ; afin de prévenir la surveillance des élèves et des enseignants ; afin de protéger contre la publicité commerciale dans les contextes éducatifs ; et afin de réglementer l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle dans l’éducation. „
- Réfléchir aux conséquences à court et à long termes du déploiement des technologies numériques dans l’éducation pour l’environnement physique, en évitant les solutions non durables sur le plan de leurs besoins énergétiques et matériels.